IL Y A
DEUX CENTS ANS,
BORY DE SAINT-VINCENT A LA REUNION
Nicole CRESTEY

1 Introduction :
Que nous reste-t-il , aujourd’hui, du
passage de Bory de Saint-Vincent à la Réunion, il y a deux cents ans ? Il
est absent des noms propres du Petit Larousse, de l’Encyclopedia
Universalis. Un cratère, un piton, des rues, un collège portent son nom à la
Réunion. Une gloire locale ? Même pas : il suffit de voir la
graphie fantaisiste de son nom sur les plaques. Il avait été oublié dans le
tome 1 du dictionnaire bibliographique de la Réunion et dans
« l’ Album de la Réunion » d’Antoine Roussin, s’il est
cité à plusieurs reprises, aucune notice ne lui est consacrée. Dans
l’Encyclopédie Larousse du XXème siècle en 10 volumes, il y a quelques
lignes mais beaucoup d’inexactitudes. Il nous a pourtant laissé son :
Ses pairs, les botanistes Agardh, La Billardière et Willdenow (Species
Plantarum), ont classé dans le genre Borya plusieurs espèces
d’algues. Un hibiscus endémique de la Réunion lui a été dédié en
1824 : Hibiscus boryanus, par de Candolle. D’autres
plantes, plutôt discrètes, des mousses, des fougères, des graminées et des
orchidées ont également un nom d’espèce qui le célèbre.

Hibiscus boryanus
2 L’expédition Baudin
QUI EST BORY DE SAINT-VINCENT ?
Il naît à Agen en 1778 dans une famille considérée, de la bourgeoisie, du
commerce et de la finance, alliée à la petite noblesse de province et ayant
acquis une récente noblesse de robe. Ils habitent une grosse bâtisse,
qui existe encore rue Lalande, à Agen. Ses parents sont de grands lecteurs des
encyclopédistes, adeptes du progrès. Il fréquente le collège d’Agen, puis
celui de Bordeaux et après sa fermeture , c’est son oncle maternel, Bernard
Journu Auber, qui se charge de son éducation. Ce riche armateur, passionné
d’histoire naturelle, habite un somptueux hôtel particulier, qui existe
encore, 55, cours Georges Clemenceau, où il possède une riche collection
de documents et d’échantillons de plantes, d’animaux et de minéraux que
les capitaines de ses navires lui rapportent du monde entier. Cet homme cultivé
du siècle des lumières en fera don au Muséum de Bordeaux où l’on peut
encore les admirer. Il aura une influence prépondérante sur le développement
de la personnalité de son neveu. Lacépède, né lui aussi à Agen, fréquente
Journu Auber. Il est déjà très célèbre. C’est un ancien élève de
Buffon. Il se prend d’affection pour Bory de Saint-Vincent et a, lui aussi,
une très grande influence sur son orientation scientifique. Toute sa vie, il
lui servira de conseiller et de protecteur. Pendant la Terreur, l’oncle et le
père de Bory de Saint-Vincent sont emprisonnés. Il se réfugie dans les Landes
où il étudie les insectes et commence un herbier. C’est un marcheur
infatigable. A 18 ans, il a lu et assimilé l’œuvre de Buffon, de Linné et
de Jussieu et il peut confronter ces travaux avec ses propres recherches. Il
publie sur les conferves (algues vertes filamenteuses) et la mise en valeur des
Landes. A 19 ans, il s’engage dans l’armée comme médecin aide major. Il
combat en Vendée avant d’assurer le commandement d’un détachement affecté
à la garde du fort de Belle-Ile-en-Mer. Sur recommandation de Lacépède, il
est nommé botaniste de l’expédition Baudin. Il a alors 22 ans. Après un
court séjour à Paris aux côtés de Lacépède , il quitte Paris le 1er
octobre
2.1 La campagne d’Egypte (1798-1801).
En 1798, Napoléon Bonaparte adjoint un bataillon de 149 scientifiques à
l’armée d’Egypte. Le mathématicien Gaspard Monge et le chimiste
Claude Louis Berthollet en sont responsables. Ces scientifiques sont surtout des
ingénieurs, fraîchement diplômés, ou même encore étudiants de l’Ecole
Polytechnique qui vient d’être fondée (en 1794). Il y a aussi 12
naturalistes (c’est le deuxième contingent après les ingénieurs),
dont le zoologiste Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire et le minéralogiste
Dolomieu, et des médecins. Le rassemblement systématique de données
scientifiques sera une caractéristique du régime napoléonien. Contrairement
au colonialisme marchand qui a précédé, l’occupation de l’Egypte comporte
une dimension culturelle. Ni les Britanniques en Inde, ni les Hollandais en
Indonésie, ni les Espagnols et les Portugais en Amérique, aucun des impérialismes
antérieurs n’a rien tenté de ce genre.
2.2 Nicolas Baudin.
Nicolas Baudin est né en 1754 à l’île de Ré. En 1786, il est
sous-lieutenant mais, dégoûté par sa situation dans la marine française, il
pose sa candidature lorsque Joseph II, empereur d’Autriche, ayant décidé de
réorganiser sa marine, recherche des officiers. Il quitte la Royale et de 1786
à 1789, Baudin effectue, aux frais de l’Empereur, un fructueux voyage dans
l’Océan Indien, d’où il rapporta une imposante collection de botanique qui
contribua à embellir le jardin impérial de Schönbrunn. Le successeur de
Joseph II, Léopold II, conserve à Baudin toute sa confiance. Il le charge, en
1793, d’une nouvelle expédition en Chine, dans les îles de la Sonde,
l’Inde et le Cap de Bonne Espérance, sur la frégate La Jardinière.
Mais, entre temps, la France a déclaré la guerre à l’Autriche. Baudin
abandonne La Jardinière et ses collections et s’embarque pour Le Havre. Un an
après, il se rend aux Antilles pour récupérer la collection constituée aux
frais de Léopold II. Il revient avec le trésor autrichien auquel se sont ajoutées
de nouvelles récoltes faites à Ténériffe, à Porto Rico ,à Trinidad, … Il
en fait don à l’ex Jardin du Roi, devenu, en 1793, le Muséum
d’Histoire Naturelle. Son directeur, A. L. de Jussieu déclare : «
Jamais il n’avait été rapporté en Europe des collections aussi considérables,
en pleine végétation et aussi bien choisies. ». La cargaison est,
effectivement si riche qu’il faut construire une serre supplémentaire – la
serre Baudin – pour abriter les plantes rapportées par Baudin. Il est proclamé
comme le plus grand navigateur et le plus grand naturaliste de tous les temps.
Il est promu capitaine de vaisseau. Bonaparte ne jure que par lui. Baudin
profite de sa notoriété et de la situation géopolitique de l’époque :
En 1787, les Britanniques ont fondé leur première colonie en Nouvelle Hollande
(Australie) : la Nouvelle Galles du Sud. L’exploration détaillée du sud
de la Terre de Van Diemen (Tasmanie), par d’Entrecasteaux, aurait pu permettre
aux Français de s’établir dans cette île et de contrôler ainsi la route
des Anglais vers Port Jackson (Sydney), c’est-à-dire menacer leur colonie de
Nouvelle Galles du Sud. Malheureusement pour la France, les troubles de la Révolution
ont arrêté net toute entreprise et les Anglais n’ont pas perdu leur temps.
Ils préparent une nouvelle expédition en 1800 et les Français le savent.
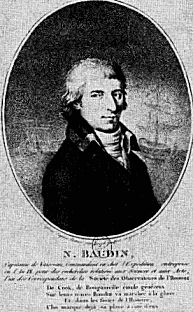 Nicolas Baudin
Nicolas Baudin
Grisé par son succès, Baudin conçoit le projet de reconnaître le littoral
sud, encore inconnu, de la Nouvelle Hollande et aussi d’effectuer un vaste périple
à travers le Pacifique où il escompte découvrir d’autres îles jusqu’au côtes
de l’Amérique du Sud.
2.3 Une organisation prestigieuse.
Dès que l’ordre intérieur est rétabli, le Premier Consul qui a envie de
savoir à quoi ressemblent les antipodes et qui veut des cartes, s’empresse
d’organiser un voyage maritime destiné à prendre pied sur les côtes encore
inexplorées de la Nouvelle Hollande, face à la Grande Bretagne, avec laquelle
on est encore en guerre. La mission, qui est naturellement confiée à Baudin,
n’a pas, officiellement du moins, de but politique. D’abord inquiets, mais
vite rassurés, les Britanniques décident que l’expédition française sera
non seulement tolérée mais, le cas échéant, assistée et secourue. Il ne
s’agissait donc que d’une mission scientifique, et Bonaparte qui, trois ans
plus tôt , avait associé les sciences à l’expédition d’Egypte, veut
donner à cette expédition toutes les chances de succès. La commission de
l’Institut de France réunie par Bonaparte, où siégeaient, à côté de
Bougainville, alors âgé de 71 ans, les zoologistes Lacépède et Cuvier et le
botaniste Jussieu, restreignent le projet initial de Baudin à la seule Nouvelle
Hollande : « l’objet que le gouvernement s’est proposé a été
de faire reconnaître avec détails les côtes du sud-ouest, de l’ouest, du
nord-ouest et du nord de la Nouvelle Hollande, dont quelques-unes nous sont
encore inconnues et d’autres connues imparfaitement… En réunissant ce
travail qui se fera sur cette partie, à celui des navigateurs anglais, nous
parviendrons à connaître le littoral de cette grande île australe. ».
On se demande encore si le cinquième continent n’est pas coupé en deux, à
peu près vers le milieu, un large détroit faisant communiquer l’échancrure
profonde de la côte sud avec le golfe de Carpentarie au nord. Dans le port du
Havre, on arme deux navires, une corvette de 350 tonneaux et 30 canons, Le Géographe,
et une grosse et forte gabare, Le Naturaliste. Les noms donnés aux deux
navires confirment les objectifs scientifiques de l’expédition.
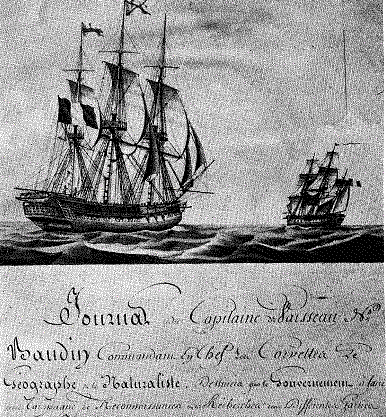
Le Géographe et Le Naturaliste.
Baudin commande Le Géographe tandis que Le Naturaliste est confié au capitaine
de frégate Emmanuel Hamelin, héros de la lutte contre la marine
britannique. Les officiers sont choisis au sein de l’élite. Parmi eux, on
distingue les deux frères Freycinet, enseignes de vaisseau âgés de 23 et 21
ans. Parmi les aspirants se trouve un jeune homme de 17 ans, Hyacinthe de
Bougainville, le fils aîné du célèbre navigateur. Par une coïncidence
curieuse, il y a, à bord du Géographe, trois Baudin sans lien de parenté.
Dans le plus pur style bonapartien, on va entasser vingt-quatre savants sur ces
bateaux. Ils ont été proposés par l’Institut et désignés par le Premier
consul lui-même. C’est l’équipe scientifique la plus importante qui ait été
rassemblée pour un voyage maritime. Elle comprend des astronomes (Frédéric de
Bissy, Pierre-François Bernier), des géographes (Charles Pierre Boulanger,
Faure), des minéralogistes (Charles Bailly, Louis Depuch), des botanistes (Léchenault
de la Tour, Bory de Saint-Vincent, Anselme Riedlay, Jacques Deslisses et André
Michaux), des zoologistes (René Maugé, Vilain, Désiré Dumont et François Péron),
des jardiniers ( Antoine Sautier, Antoine Guichenault) et des peintres et
dessinateurs (Charles-Alexandre Lesueur, Nicolas Martin Petit, Jacques Milbert,
Lois Lebrun, Michel Garnier). En tout il y a une centaine d’hommes sur Le Géographe
et une dizaine de moins sur Le Naturaliste.
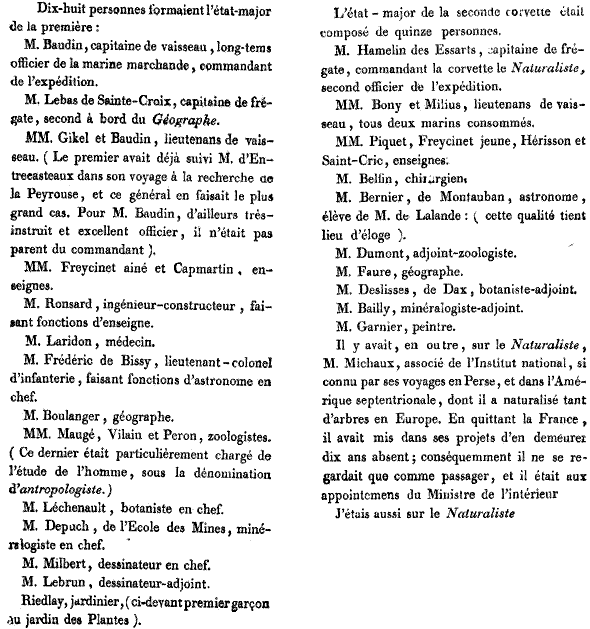
La
composition des Etats-Majors.
On a déjà vu avec l’expédition d’Egypte
que le futur empereur ne faisait pas les choses à moitié. Les deux bateaux
sont très bien équipés. Une partie des cales a été spécialement aménagée
non seulement pour y entretenir des plantes vivantes emportées de France, mais
pour y préparer les semis des graines récoltées au cours du voyage. Sur les
ordres de Bonaparte tout est prévu pour assurer la bonne santé de l’équipage :
les cales regorgent d’approvisionnements et de rafraîchissements
soigneusement choisis, des appareils distillateurs se trouvent à bord de chacun
des vaisseaux. Des instructions sanitaires complètes ont été rédigées spécialement
par le premier médecin de la Marine, Kéraudren. L’expédition est munie de
passeports délivrés par tous les gouvernements d’Europe. Elle dispose de crédits
illimités ouverts dans les principaux établissements européens en Afrique et
en Asie. On est si sûr de sa réussite qu’une médaille nationale est frappée
d’avance par la Monnaie. C’est le premier automne du siècle. Cela
commence par un festin. On jure : « union entre les officiers et les
savants … Tous ceux qui se désuniront seront punis du mépris des
autres. ».Salués par une fanfare militaire et des salves d’artillerie,
Le Géographe et Le Naturaliste quittent Le Havre le 19 octobre 1800. Du 1er
au 13 novembre, les deux bâtiments font leur première escale aux Canaries.
2-4 Une ambiance conflictuelle.
En fait si on a atteint les Canaries sans encombre, dès le départ la mauvaise
entente règne à bord . Le commandant, c’est le moins que l’on puisse
dire, ne se montre pas tendre envers les savants. Ils sont nombreux. Les représentants
de chaque discipline sont au moins deux, sinon trois, de manière à prévenir
toute défaillance. Baudin s’en inquiète : « Le nombre des
sujets m’en parut beaucoup trop considérable et je fis même à cet égard
quelques objections : mais elles furent sans effet. ». Il s’agit le
plus souvent de jeunes gens enthousiastes et curieux, remarquables par l’étendue
de leurs connaissances, mais peu capables de se plier à la discipline du bord
et qui, très vite se sont trouvés en conflit avec un commandant dur et
autoritaire. Baudin est un loup de mer orgueilleux, maître et esclave de la
consigne, et qui ne badine pas avec l’horaire de marche, lequel, évidemment
s’accorde mal avec les nécessités de l’observation scientifique. Même à
terre, Baudin prétend réglementer, limiter les sorties Or les jeunes
savants entendent bien mener leurs recherches à leur guise. De plus ils sont
nombreux, ils se sentent en force et n’ont nullement envie de se laisser
brimer par un marin. Enfin, lorsque Péron et Bory de Saint-Vincent, les
premiers, se mettent à formuler des critiques envers Baudin, certains officiers
et une partie de l’équipage se rangent de leur côté. De plus, au nombre des
savants figurent quatre des anciens compagnons de la dernière expédition de
Baudin : l’astronome Bernier, le zoologiste Maugé, l’aide-naturaliste
Vilain et le jardinier Riedlay. Baudin fait nettement preuve de
favoritisme à leur égard, dès l’escale des Canaries. Ils s’en sont
donnés à cœur joie . A ce sujet, le peintre Milbert écrit : « Nous
vîmes venir à nous, au travers de ces charmantes solitudes, le bon M. Riedlé,
jardinier en chef de notre expédition ; il était accablé sous le poids
de son ample récolte : il la déposa près de nous et étala glorieusement
toutes ses richesses. » Peu après parut le zoologiste Stanislas
Levillain : « Son chapeau tout couvert d’insectes enfilés avec des
épingles lui donnait un air assez comique : sa boîte en était
pareillement bien garnie. » ; Tous deux ont pu confier leur
abondante récolte pour le Muséum à un bâtiment espagnol qui retournait à
Cadix. Tandis que Bory de Saint-Vincent, amer, écrit : « Un
voyageur, quand il a demeuré onze jours à Ténériffe, doit trembler en
avouant qu’il n’a pas visité ce qu’il y a de plus remarquable dans l’île ;
mais des raisons qui, quoique je ne croie pas devoir les déduire, n’en
sont pas moins puissantes, m’empêchaient d’entreprendre beaucoup de
choses que j’eusse désirées. Des considérations invincibles m’arrêtèrent
dans des projets bien dignes du début d’un voyage de découvertes ; et
par la suite de ces considérations, les derniers jours de notre relâche furent
à peu près perdus pour moi. Je ne pus me permettre de faire des excursions
dans le pays, ni de m’éloigner du bord : on nous parlait sans cesse de départ ;
c’était toujours l’après-dîner ou le lendemain matin qu’on devait
mettre à la voile, ou bien il n’y avait pas de canots, ou, etc. etc. etc. Le
commandant fit d’ailleurs entendre qu’il regardait comme inutile tout ce
qu’on pouvait faire pour la science dans un pays qui, selon lui, était
parfaitement connu. ». Baudin le confirme dans son journal : « Comme
les lieux qu’ils ont parcourus sont déjà très connus, les remarques
qu’ils ont pu faire ne sont utiles que pour eux… »
2-5 Une logistique défaillante
Dès le départ, Bory de Saint-Vincent est contrarié : « Je ne pus
recevoir une caisse de livres que M. de Lacépède avait eu la complaisance de
m’adresser ; ces livres m’auraient été d’autant plus utiles, que la
bibliothèque des corvettes était une dérision. Excepté quelques bons
voyages, la treizième édition du Systema Naturae, le Genera
Plantarum, de M. de Jussieu, les ouvrages de MM. Ventenat et Lacépède, il
n’y avait pas un seul livre qui pût nous être de quelqu’utilité : je
ne sais, en vérité, qui avait pu faire un pareil choix. A la place du Dictionnaire
de Trévoux, de l’ancienne Encyclopédie, des Mémoires de Réaumur,
… il eût beaucoup mieux valu nous donner Kaempher, Bloch, Fabricius,
Swartz, Burman, Plumier, Rumph, Rheede, l’Encyclopédie Méthodique, etc. ».
Plus grave : Baudin commet une erreur de navigation. Au lieu de prendre le
large, il longe les côtes de l’Afrique. Cela vaut à tout le monde 145 jours,
près de 5 mois, de navigation épuisante, exaspérante pour gagner l’Ile de
France. Tantôt on est immobilisé par les calmes équatoriaux, tantôt assailli
par de violentes tempêtes. Milbert note : « Entourés de toutes
parts d’un fluide qu’on peut comparer à un vaste étang d’huile, réfléchissant
la couleur d’un ciel gris voilé jusqu’aux bornes de l’horizon, on n’est
tiré de ses sombres rêveries que par la houle qui soulève lourdement le
navire, et le fait tourner sur lui-même dans tous les sens sans qu’il soit
possible de lui donner la moindre direction. ». Les réserves de vivres
s’épuisent. Le scorbut rôde. Bory de Saint-Vincent en ressent les premières
attaques. Les civils se découragent. La tension monte. Pour passer le temps, on
écrit beaucoup à bord du navire, généralement pas pour célébrer le
commandant. La responsabilité de Baudin est manifeste. Lors
de son second voyage déjà, en 1773, James Cook, avait mis fin au mythe des expéditions
maritimes meurtrières. Il avait vaincu le scorbut en chargeant ses cales de
fruits et de légumes et n’avait eu aucun mort à déplorer.
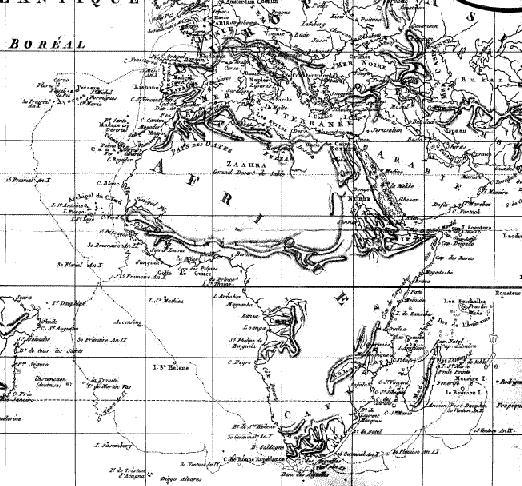
Les itinéraires aller (départ du Havre) et
retour (arrivée à Bordeaux) de Bory de Saint-Vincent.
Nouveau contretemps à l’Ile de France où
l’on arrive enfin le 15 mars 1801 : le troisième vaisseau promis, qui
devait se joindre à l’expédition, ne l’attend pas à cette escale. La
mission n’est pas bien accueillie. L’île de France craint d’être obligée
de libérer ses esclaves. Le commandant s’étant pris de querelle avec
l’ordonnateur local qui devait procurer les vivres, le ravitaillement est
insuffisant. Au moment de partir, certains – Bory de Saint-Vincent, Milbert et
André Michaux – qui estiment que l’expédition ne pourra mener à rien tant
qu’elle sera sous les ordres de Baudin, décident de rester. C’est une désertion
massive : quarante hommes refusent de continuer le voyage. Il y a parmi eux
plusieurs officiers : deux des trois lieutenants du Géographe et un des
deux lieutenants du Naturaliste. Une partie importante des membres de l’équipe
scientifique reste également à l’Ile de France, les uns étant malades, les
autres ne pouvant plus supporter l’autoritarisme de Baudin. Restent à l’Ile
de France, le 25 avril 1801, l’astronome Frédéric de Bissy, les
botanistes André Michaux, Jacques Delisle et Bory de Saint-Vincent, le
zoologiste Désiré Dumont et les peintres Jacques Milbert , Louis Lebrun et
Garnier. Il est très possible que le gouverneur de l’île de France ait tout
fait pour tenter de retenir Le Géographe et Le Naturaliste afin d’avoir
des bateaux supplémentaires en cas d’attaque anglaise. Bien que médecin
militaire, Bory de Saint-Vincent n’émet pas un diagnostic catégorique de ses
problèmes de santé : « Soit que le roulis, qui ne me causait pas
d’angoisses, m’éprouvât d’une autre manière, ou que la vie sédentaire
que nous menions fût absolument contraire à mon tempérament ; soit
encore que l’air salin et humide de la mer que nous respirions depuis si
longtemps, me fût nuisible, ou enfin que le peu de mauvaises nourritures
qu’on nous servait à déjeuner et à dîner m’eussent affecté de scorbut,
je ne dormais plus : j’éprouvais une pesanteur dans les jambes,
accompagnée d’une enflure très remarquable, surtout le soir ; une toux
presque continuelle et une maigreur vraiment extraordinaire m’étaient des
signes alarmants d’un grand délabrement de santé. ». Au moment
de se rembarquer, il rapporte : « Cependant la mauvaise santé
de Dumont, de Garnier, de Gickel, de Bony, de Capmartin, de Baudin et de Milbert,
nous faisait craindre de les voir se séparer de nous. Deslisses et moi, encore
plus malades, étions incertains sur le parti que nous aurions à prendre, au
moment de nous rembarquer. .. Péron, Milius, Bernier et Faure étaient
aussi à l’hôpital. » C’est une véritable hécatombe !
3 BORY DE SAINT-VINCENT
Malgré le respect que lui impose sa jeunesse,
le sentiment de vivre une expérience extraordinaire et au mépris de tous les règlements
militaires, Bory de Saint-Vincent a été parmi les premiers à réagir contre
Baudin. On ne peut que faire l’éloge de sa désobéissance. C’était, en
fait, sage prévoyance, pressentiment avisé. Des quatre anciens compagnons de
Baudin, aveuglés par leur fidélité, manquant d’esprit critique, aucun
n’a revu la France. Le zoologiste Maugé, avant de mourir le 21 février 1802,
écrit à Baudin : « C’est pour vous avoir été trop attaché que
je meurs et que j’ai méprisé les conseils de mes amis, mais, au moins,
souvenez-vous de moi, en récompense du sacrifice que je vous ai fait. ».
Des 24 scientifiques embarqués, seuls 6 ont revu la France et encore 2 sont
morts peu après leur retour des suites du voyage. Heureusement,
avec la protection du gouverneur de l’Ile de France, Magallon de la Morlière,
qui apprécie les passagers et les officiers de l’expédition, Bory de
Saint-Vincent réussit à se faire attacher à son état major et, le 23 mai, se
fait confier une mission de découverte de l’île de la Réunion..
Qui était ce Bory de Saint-Vincent lorsqu’il a été désigné
comme botaniste de l’expédition Baudin ?
3-2
LE VOYAGE DANS LES QUATRE ILES PRINCIPALES DES MERS D’AFRIQUE
C’est « la relation d’un voyage dont l’agriculture, l’histoire
naturelle, un peu de géographie et des considérations commerciales remplissent
presque tout le fond. » C’est le rapport de mission d’un militaire :
« L’auteur de cet ouvrage (…) veut seulement s’acquitter d’un
devoir. Envoyé par le gouvernement, il lui a dû compte de ce qu’il a cherché
à faire pour le progrès des sciences ». Au XVIIIème siècle, les
voyages de circumnavigation ont étendu au monde entier le champ de l’histoire
naturelle. Les naturalistes qui prennent part à ces voyages ont à cœur de
compléter les travaux de Linné et de Buffon qui viennent d’être publiés et
de combler leurs vides. Les nouvelles éditions enregistrent au fur et à mesure
les découvertes, résolvent les questions nouvelles, permettent de plus vastes
synthèses et se succèdent à un rythme rapide dans les dernières années.
Zoologie et botanique connaissent alors, même dans le grand public, un succès
sans précédent.
C’est dans cette lignée que s’inscrit Bory de Saint-Vincent.
Malheureusement ses bagages sont légers et il n’a pas de bibliothèque pour
lui permettre la consultation d’auteurs, mais il a une excellente mémoire.58
planches illustrent l’ouvrage. Elles sont dessinée par Bory de Saint-Vincent,
reprennent une partie des œuvres de Jean Joseph Patu de Rosemont publiées en
1792 sous le titre « Bourbon pittoresque ». Patu de Rosemont, arrivé
en 1788 à la Réunion, est un voisin de Joseph Hubert. Parmi ces planches se
trouvent des cartes, dont la première quelque peu détaillée de l’île,
« à une échelle double au moins de toutes celles qui ont été faites,
et sextuple des plus grandes qui aient été gravées », qui a été faite
en collaboration avec l’ingénieur Chisny pour les littoraux ( « Par les
soins de M.Chisny, ingénieur, les côtes et leurs détails ont enfin été
relevés d’une manière assez exacte ») et d’après la carte de Lislet
Geoffroy publiée en 1797 pour le dessin des montagnes. Les 15
planches de botanique sont signées Poiteau.
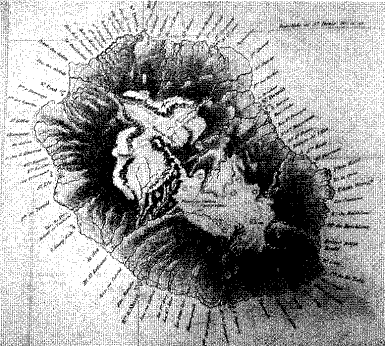
Carte de Lislet-Geoffroy
C’est un reportage complet, précis et
c’est le premier qui soit consacré à l’île de la Réunion. Le livre
obtient un franc succès du public et Bonaparte le remarque. Bory de
Saint-Vincent lui doit sa nomination de membre correspondant de l’Académie
des Sciences le 20 juin 1808. En 1895, le botaniste E. Jacob de Cordemoy écrit : «
Cet ouvrage dénote chez ce naturaliste de 22 ans une perspicacité, une
justesse de vue peu communes . Ses aperçus sur la formation de l’île,
sur les caractères de sa flore, sont vraiment remarquables. Ce livre doit être
lu par toute personne qui s’occupe de l’histoire naturelle des Mascareignes ».
3-3 BORY DE SAINT-VINCENT A LA REUNIONIl
arrive dans l’île le 12 août 1801. Il quitte la Réunion le 6 décembre
1801, soit un peu moins de 4 mois plus tard. Le « Voyage dans les quatre
principales îles des mers d’Afrique » est un véritable journal de son
séjour à la Réunion. La table des chapitres de chacun des 3 volumes est éloquente.
17 chapitres sur un total de 25 sont consacrés à la Réunion.
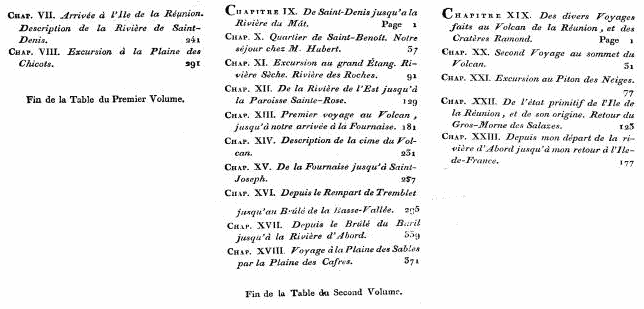
Le Général Jacob était alors gouverneur.
Bory de Saint-Vincent a rencontré à Saint-Benoît Joseph Hubert qui avait
alors 55 ans, était membre correspondant de l’Académie des Sciences et avait
fait l’une des premières excursions au Piton de la Fournaise en compagnie de
Commerson en 1771. Il est difficile d’imaginer que Bory de Saint-Vincent a
fait un tel périple avec les moyens de locomotion de l’époque, l’absence
de sentiers pour aller au Volcan et au Piton des Neiges, et autant rédigé
alors qu’il n’avait pas de documentation et que les communications étaient
si difficiles.
3-4 UNE CULTURE SCIENTIFIQUE ETONNANTE
Dans la bibliothèque des corvettes, Bory de Saint-Vincent a trouvé « quelques
bons voyages ». On peut supposer qu’il s’agit, puisqu’il les cite,
de :
« Histoire de la Grande Ile de Madagascar » de Flacourt (1658).
« Aventures aux Mascareignes » de François Leguat (1707).
L’abbé de Lacaille 1713-1762) est cité.
Manuscrit de Donnelet (1760) :« Le premier voyage que je sache avoir
été entrepris pour visiter la Montagne ardente, le fut en 1760 par le sieur
Donnlet, habitant du pays ; et ce que j’en sais, je l’ai trouvé dans
un petit manuscrit de 28 pages in-18, que M. Faujas acheta par hasard sur
un quai de Paris, et qu’il a bien voulu me communiquer. »
Relation de l’expédition, en 1761, de Guy Alexandre Pingré et de Borda pour
l’observation du passage de Vénus devant le Soleil à l’île Rodrigues.
Les notes de Aubert Dupetit Thouars, qui a visité Maurice, Madagascar et la Réunion
surtout, entre 1795 et 1799, car ses ouvrages ont été publiés ultérieurement.
Les voyages de Cook.
Les notes de Commerson, mort en 1773, sans avoir rien publié. Son herbier, le
plus considérable qu’on n'ait encore jamais vu, ses notes, ses descriptions,
ses dessins se trouvent aujourd’hui au Muséum. Bory de Saint-Vincent se réfère
à «… un dessin de Commerson que j’ai sous la main… »Il
met cependant le doigt sur les lacunes de sa documentation : « le
voyageur errant sur le globe, où il se transporte de contrées en contrées, et
qui cherche à lire dans la nature même, en comparant ses productions sur les
lieux où elle les prodigue, ne peut, pendant ses excursions lointaines, se
tenir au courant des découvertes que font les savants sédentaires de
l’Europe ». Ceci ne l’a cependant pas empêché d’être un esprit
universel, ouvert à tout : médecin militaire, botaniste officiel de
l’expédition, il s’est intéressé en outre à l’astronomie, la
cartographie, la géologie, la minéralogie, la volcanologie, la zoologie, le
dessin, la géographie …Il s’est passionné pour les mesures à l’aide de
thermomètres, baromètres.
A son arrivée à l’Ile de France, la quarantaine est de rigueur, car il y a
eu une épidémie de variole 15 ans auparavant. Il s’étonne que la
vaccination, découverte par Jenner en 1796, n’ait pas été rendue
obligatoire : « Si les habitants entendaient à cet égard leurs véritables
intérêts, ils profiteraient de la découverte importante de la vaccine pour
inoculer tous les noirs et les blancs qui ont échappé à la dernière épidémie,
ou qui sont nés depuis ce temps ; »
Même s’il n’a pas séjourné longtemps à Paris, seul véritable centre
intellectuel de l’époque, il a bien mémorisé les ouvrages de références
qu’il a étudiés chez son oncle et qu’il a retrouvés sur Le Naturaliste :
la 13ème édition du Systema Naturae de Linné, le Genera
Plantarum de Jussieu, l’ Anatomie comparée de Lacépède. Pendant son
voyage,il correspond sans doute avec ce dernier qui peut ainsi publier en 1802
sur les poissons d’eau douce de la Réunion. Son ami Péron est un élève de
Cuvier. On verra qu’il a tout un réseau de correspondants. C’était un
esprit très ouvert qui met à profit tous ses échanges avec les personnes
ressources qu’il rencontre.
Sa mission est essentiellement d’herboriser et de décrire. Comme on l’a vu,
il s’agit pour lui de compléter les ouvrages de Linné et de Jussieu qui font
autorité. En géologie, la période est à la polémique, les esprits
s’affrontent. Comment Bory de Saint-Vincent se situe-t-il ?
Dès l’Antiquité, les philosophes ont cherché à expliquer les phénomènes
géologiques qui affectent le bassin méditerranéen. Ils pensent que des
ouragans souterrains font vibrer les parois de cavités et provoquent des feux
de matières inflammables. Le terme de basalte a été créé par Pline
l’Ancien. La géologie est alors spéculation pure, affaire de philosophes. Au
Moyen-Age, on néglige les volcans. Le savoir se cantonne dans les monastères.
L’invention de l’imprimerie va permettre de redécouvrir les textes de
l’Antiquité mais ceux-ci doivent respecter les notions d’enfer et de déluge.
Au XVII et XVIIIèmes siècles, la géologie quitte le domaine des opinions pour
celui des sciences. Tout d’abord, au dogme de l’église on cherche à
opposer un autre dogme. L’interprétation de l’histoire de la Terre est
retirée aux religieux. Le géologue ne réfléchit plus dans sa chambre sur la
formation de la Terre, il doit aller sur le terrain. Et le terrain est de plus
en plus vaste : Bougainville effectue le tour du monde de 1766
à 1769, Cook découvre Hawaii et ses volcans en 1779 … Pour les
neptunistes, toutes les roches, y compris le basalte se sont formées dans les
mers. A la suite des travaux de Lavoisier, on est convaincu que les volcans sont
dus à des feux de charbon ou de graisse d’animaux enfouis dans les sédiments.
Le volcanisme et les séismes sont des phénomènes superficiels. La prismation
des basaltes serait due à une dessiccation, comme les craquelures de la boue
qui sèche. Pour les plutonistes, il n’y a pas de feux souterrains. Les
volcans sont en communication avec le noyau terrestre en fusion.La chaleur
interne est périodiquement évacuée par les éruptions. Les roches volcaniques
sont le résultat d’une fusion et non d’une combustion. La fin du XVIIIème
siècle voit la victoire des plutonistes.
Bory de Saint-Vincent est en avance sur son temps. Il faut dire que la nature
volcanique de la Réunion est connue depuis le début de son occupation
par les Européens tandis que ce n’est que le 10 mai 1752 que Guettard annonce
à l’Académie des Sciences que les montagnes d’Auvergne sont des volcans éteints.
Guettard n’a jamais vu de volcan, mais il a examiné des laves du Vésuve et
de l’Ile Bourbon dans le cabinet d’histoire naturelle du Duc d’Orléans
dont il est le conservateur. Grâce à la collaboration de personnes cultivées,
férues d’histoire naturelle telles son ami Joseph Hubert et le capitaine
Bert, Bory de Saint-Vincent a pu reconstituer l’histoire du Piton de la
Fournaise. Il a la chance d’assister à deux reprises, à une éruption dans
le cratère sommital avec lac de lave et émission d’une grande coulée qui
atteint la mer, qui a duré du 27 octobre à novembre1801. Il décrit tout en détail.
Rien ne lui échappe : les différentes sortes de coulées, les roches avec
ou sans olivine, les tunnels sous-laviques et même les fils de verre
volcaniques que, cinquante ans plus tard, on appellera « cheveux de Pélé »
à Hawaii … Et il apporte une explication exacte de tous ces phénomènes. Aux
principaux cratères du Piton de la Fournaise, il donne les noms d’illustres
savants de son temps :
Dolomieu, célèbre minéralogiste dauphinois, étudie les roches
basaltiques du Portugal en 1778. Il multiplie ensuite les voyages sur le terrain :
Sicile, Pyrénées en 1782, île d’Elbe, Corse et Alpes en 1789, qui lui
permettent d’accumuler une impressionnante collection de minéraux. En 1798,
il se joint à l’expédition d’Egypte. Ses études et observations sur les
substances volcaniques lui ont valu la célébrité. Ses travaux portent également
sur les tremblements de terre, l’interprétation de l’évolution géologique
de la Terre. En 1798, il affirme que les laves proviennent d’un amas de matière
pâteuse et visqueuse situé sous l’écorce consolidée du globe. Pour la
première fois, le volcanisme est relié à l’intérieur du globe. Il meurt en
1801. Il a nommé de nombreux pitons en honorant ainsi les sommités
géologiques de son temps :
Faujas de Saint-Fond est le premier titulaire de la chaire de géologie du
Muséum d’histoire naturelle créé par le décret du 10 juin 1793 en
remplacement du Jardin du Roi. Douze cours y sont institués qui donnent au Muséum
des activités de recherche bien structurées. Faujas est l’auteur de l’un
des premiers traités sur les volcans. Il y affirme l’origine ignée du
basalte.
Haüy a fondé la cristallographie et inventé la notion d’unité de
plan, notion féconde qui sera reprise en anatomie comparée.
Lislet Geoffroy.
Bert.
Commerson.
Ramond.
Chisny.
Joseph Hubert.
Dupetit Thouars.
Il ne s’oublie pas avec le cratère sommital Bory !
Pendant plus d’un siècle ses travaux feront autorité. Il a ouvert la voie de
la recherche scientifique à la Fournaise. Il a finalement laissé plus de
souvenirs à la Réunion comme géologue que comme botaniste, car la plupart des
noms qu’il a donnés sont encore en vigueur. Le nom de la Plaine des Osmondes
(et non des Ossements !) lui est dû aussi. En réalité, s’il y a bien
des Osmondes à la Réunion à la Plaine des Palmistes où elles sont
actuellement très menacées par l’urbanisme, il n’y en a pas dans
l’Enclos. Ce qu’il a pris pour des Osmondes sont en réalité des Blechnum,
mais le nom est resté.
4 CONCLUSION
A son retour en juillet 1802, il est accueilli avec bienveillance par Bonaparte.
Il reprend immédiatement sa carrière militaire à tel point
qu’il doit même confier l’édition du « Voyage » à son ami
Dufour. Tout en participant aux principales campagnes de Bonaparte et au hasard
de ses déplacements en Europe, il poursuit ses recherches de botanique et de
cartographie, réalise des croquis, dresse des plans, constitue des herbiers. Il
reçoit les honneurs, doit s’exiler pour raisons politiques, fait de la prison
pour dettes, est élu député, a de nombreuses liaisons, publie ses travaux...
Il meurt le 22 décembre 1846 de problèmes cardiaques. Son herbier est
vendu. Les Fougères et les Champignons iront au Muséum où ils se trouvent
encore.
Jusqu’à la fin de sa vie, pourtant bien mouvementée et dans une période qui
ne l’était pas moins, Bory de Saint-Vincent n’a jamais cessé de
s’occuper des plantes de la Réunion, cette île qu’il a tant admirée et
dont il gardait un souvenir enchanteur : « votre paradis terrestre,
votre splendide mascareigne, votre délicieux pays, votre île qui m’est si chère,
où j’ai passé les jours les plus heureux de ma vie » écrit-il. Et
encore : « que ne donnerais-je pour une seule promenade dans vos
verdoyants bassins de rivière ou sur la Plaine des Chicots ! Que vous êtes
heureux de pouvoir en quelques heures, quand la fantaisie vous en prend
gravir de si beaux lieux ». Il entretenait une correspondance suivie avec
Claude Richard, directeur du Jardin botanique de Saint-Denis. En 1802 Joseph
Hubert lui envoie un compte rendu de l’éruption qui s’est produite du 17
janvier au 14 avril, après son départ. En 1812, c’est un colon, du nom de Le
Gentil qui lui décrit l’une des plus importantes éruptions du siècle. Bory
de Saint-Vincent en fait une description devant l’Académie des Sciences.
Bory de Saint-Vincent n’a passé que quatre mois à la Réunion, mais il y a
laissé beaucoup de lui. Le « Voyage » a été un véritable
best-seller à l’époque. Combien de personne a-t-il incitées à venir à la
Réunion. La Réunion le lui rend-elle ?
5 SUITE
Suite à cette conférence donnée le 12 juin 2001 aux Amis de l’Université
pour commémorer le séjour à la Réunion en 1801 de Bory de Saint-Vincent,
conférence dont le texte a été mis sur le site des Amis de l’Université,
j’ai eu la joie de recevoir le 25 avril 2003 un mail de Thomas Rouillard qui
m’annonçait qu’on avait retrouvé, début 2001, au Muséum d’Histoire
Naturelle d’Angers, un herbier de Bory de Saint-Vincent, fondu dans
l’herbier général de la ville, actuellement en début d’inventaire. Cet
herbier compte environ 250 boîtes de 250 planches soit environ 62500 planches
au total. Les sondages effectués sur 12 boîtes montrent que les planches de
Bory sur les Mascareignes représentent 12% de l’ensemble. Il y aurait donc
environ 7500 planches de Bory, ce qui est considérable. Les autres herbiers
auraient comparativement un nombre de planches de Bory tout à fait anecdotique
(de nombreux herbiers où figure le nom de Bory ont été contactés en
utilisant IPNI et Index Herbariorum). Le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris
qui a des planches de Bory, n’a que des fougères de la Réunion et les
planches de son expédition dans le Péloponnèse.
L’arrivée de cet herbier à Angers est en partie mystérieuse. Bory de
Saint-Vincent, mort en 1846, ne laissa que des dettes en fait d’héritage.
Leur montant devait en être si élevé que ses deux filles, Clotilde et
Augustine, renoncèrent à la succession. La seule chose de quelque valeur
qu’il laissa fut son herbier, objet de sa fierté. Bory l’estimait à 35000
francs mais il ne fut vendu que 6000 francs en mai 1847. C’est le
docteur Camille Montagne, un ami et voisin de la famille, retraité de l’armée
fréquentant les milieux savants de Paris, qui a également laissé un herbier
de 60 000 cryptogames au Muséum de Paris, qui s’est chargé de la
vente. L’herbier de Bory se trouvait, on ne sait comment, dans l’herbier du
Docteur de Lens, un botaniste parisien, herbier qui a été légué par son fils
à la ville d’Angers dans les années 1848-1850.
Tout ceci m’a incitée à me rendre à Angers dès le 17 juillet 2003. La
ville d’Angers est depuis longtemps un pôle d’excellence en matière de
botanique avec son Muséum d’Histoire Naturelle et son Musée Botanique :
la Société des Botanophiles y a été fondée en 1777 et y a créé son Jardin
Botanique en 1789. Alexandre Boreau (1803-1875) est nommé directeur du Jardin
Botanique en 1838. C’est certainement lui qui reçut l’herbier de Bory de
Saint-Vincent. En 1863, Gaston Allard (1838-1918) débute l’aménagement
d’un arboretum, à la Maulévrie. En 1960, la ville d’Angers acquiert
l’arboretum où elle installe le Musée botanique. Aujourd’hui l’herbier
d’Angers est le 6 ou 8ème de France. Denise Moreau professeur de
S.V.T. à la retraite est le conservateur du Musée Botanique.
L’herbier de Bory présentait une particularité : les échantillons étaient
fixés sur du papier blanc, collé lui-même sur du papier rouge, le tout enfermé
dans des chemises bleues. C’était un herbier « révolutionnaire ».
Comme on le voit cette particularité n’a pas été conservée. De même l’étiquetage
a été modifié. Les planches ont été reclassées dans l’herbier à la fin
du XIXème siècle. Pour le cannelier, qui a rajouté «
h. d. B. St. V. » à l’encre rouge ? Et la référence au
Systema Naturae dont Bory ne disposait pas sur le terrain ? Les planches ne
sont pas datées et comportent la mention imprécise « Ile de France -
Ile Bourbon ». Heureusement, on a la possibilité de les
mettre en parallèle avec son « Voyage » ce qui est rarement le cas
des herbiers historiques. Par exemple Bory visite le « Jardin
national » dans le quartier des Pamplemousses. Il écrit : « Parmi
le grand nombre de beaux arbres plantés dans les carrés dont le jardin est
coupé, je remarquai surtout le cannelier de Ceylan, Laurus cinnamomum
…» Cet échantillon aurait donc été récolté à L’île Maurice et non au
Jardin de l’Etat ni chez dans le carré Poivre chez Joseph Hubert comme
mentionné sur l’étiquette. Pour l’avocatier, au contraire il aurait été
récolté à Saint-Denis. Bory dit que l’ « avocayer »
fait partie « des arbres d’utilité ou d’agrément les plus communs
dans le quartier ».Piper hircinum, holotype de Bory de
Saint-Vincent, devenu Peperomia borbonensis n’est pas cité dans le
« Voyage » comme Piper trinerve. Une étiquette en français
le déplore et est postérieure à l’édition 1804 du Voyage et au changement
de genre en 1843. D’après la Flore des Mascareignes l’échantillon de Bory
aurait été étiqueté de Maurice ! De quel échantillon s’agit-il ?
Celui-ci est précisément étiqueté « Bois de Bourbon ». Bien des
interrogations qui justifieraient une étude plus approfondie… au moins pour
les 113 types de Bory de Saint-Vincent recensés dans l’index de Kiew.
6 ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

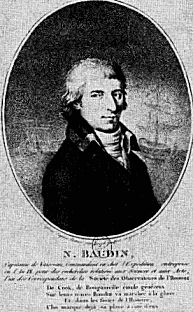 Nicolas Baudin
Nicolas Baudin